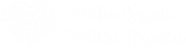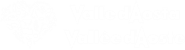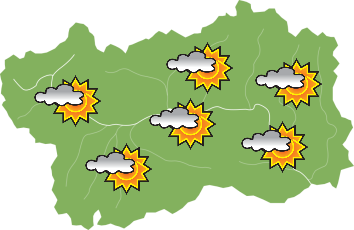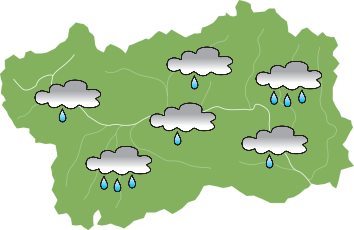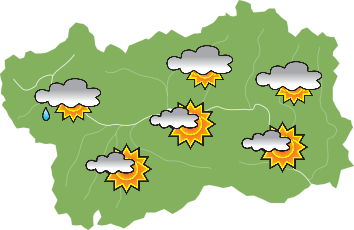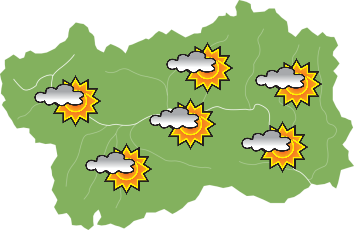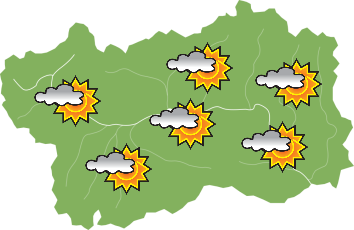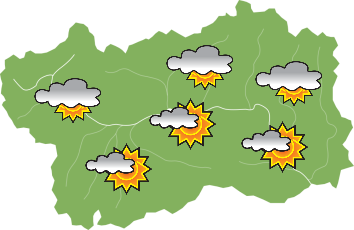La digue de Place Moulin
Architecture - BionazLa haute vallée de Bionaz a vu son paysage changer radicalement entre 1961 et 1965, lors de la construction de l’énorme digue de Place Moulin. Le barrage a créé le lac de Prarayer, un bassin artificiel encadré de montagnes. Les Petites et les Grandes Murailles, et leurs imposants glaciers, se découvrent en arrière plan.
Il s’agit du bassin d’eau le plus grand de la région et l’un des barrages les plus grands d’Europe. Il suffit de communiquer quelques données sur la structure pour en comprendre l’aspect prodigieux:
- le barrage fait 155 mètres de haut et 678 mètres de longueur
- l’épaisseur maximum à la base du barrage est de 47 mètres et de 6 mètres au sommet
- le volume du barrage est de 1 510 000 mètres cubes de ciment
- le niveau maximum atteint par l’eau est de 1969 mètres au-dessus du niveau de la mer
- la capacité du barrage est de 105 millions de mètres cubes.
L’installation peut être visitée librement à l’extérieur, mais sur réservation il est possible de profiter d’une visite guidée à l’intérieur dans la période de mai à septembre. Le barrage peut être visité sur plusieurs niveaux, qui descendent aussi sous les eaux du lac, et sont reliés entre eux par des escaliers et un ascenseur. De nombreuses machines et appareils sont installés à l’intérieur et permettent le fonctionnement de la digue ainsi que le contrôle des conditions de sécurité.